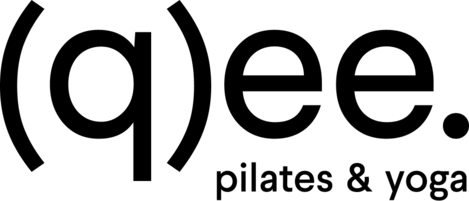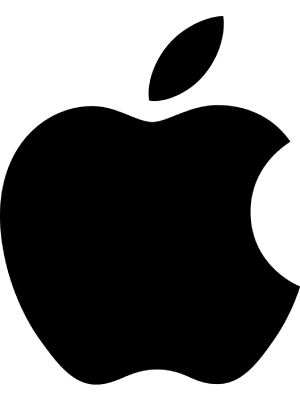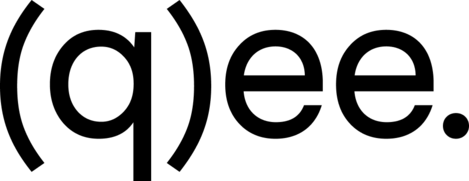Les méditations et billets d’humeur de Marie Paule Faure
Chaque mois, Marie Paule Faure, enseignante en méditation chez (q)ee, nous propose ses interrogations et réflexions.
Découvrez ce mois-ci sa méditation et son partage autour du thème des vacances
J’aime le double sens du mot. Celui dans lequel on l’emploie habituellement, synonyme de « congés » et celui faisant allusion à un quelque chose d’inoccupé. Dans les deux cas, il s’agit d’une parenthèse, d’une période d’attente, d’un « vide », entre deux « pleins ».
Notre société est très ambivalente sur la notion de ce « vide », de ce « rien » provisoire, temps suspendu entre deux obligations, deux injonctions, temps d’errance entre l’agitation incessante dans laquelle nous faisons ce que nous faisons, et du jour au lendemain, ce sentiment d’être dans une obligation de repos. Fascination pour ce « temps pour soi » devenu un luxe, attirance délicieuse, mais aussi peur de l’inaction, de l’oisiveté, qui est, c’est bien connu, « Mère de tous les vices ». Le fait d’être inoccupé soulève immédiatement en nous un tsunami de sentiments contradictoires. Car derrière cette idéalisation de la vacance du corps et de l’esprit, d’une vision quasi poétique du ralentissement, se cache souvent l’intranquillité, souvent, nous transportons avec nous, en vacances la pression du quotidien, celle-là même que nous cherchons à fuir et qui nous colle aux basques comme un invité-boulet. Impossible de lâcher, d’être véritablement insouciant. Comment est-ce que « ne rien faire » a pu devenir un tel objet de culpabilité, de remords? Et de désir?
Et comment traduire quelque chose qui est de l’ordre du non-faire, alors que nous venons d’une culture qui nous a si peu équipés pour ça, qui nous enjoint à être plus productifs, plus performants, sous peine de nous sentir paresseux, inefficaces et donc coupables et qui en même temps nous démontre l’urgence, avec force études scientifiques, de lutter contre l’esclavage du faire et de mettre notre corps et notre cerveau au repos ?
Mais surtout quand et comment avons-nous perdu cette capacité d’insouciance, de légèreté ? Et est-ce nouveau ? J’ai trouvé ce témoignage d’un ouvrier, évoquant ses premiers « congés payés » en 1936 :
« Si vers 4 ou 5 heures avec les copains, j’avais envie d’aller faire un tour ou une partie de belotte, c’était permis. On avait presque mauvaise conscience. Jouer à la belotte à 4 heures et demie, payé par le patron, dans notre psychologie, notre manière de voir, je ne dis pas il n’y avait là peut-être pas une mauvaise conscience mais une inquiétude. »
Si le stress lié au monde du travail a accentué cette inquiétude, si l’omniprésence de nos portables y compris en vacances est un frein monumental au fameux « lâcher prise », puisqu’ils nous relient nuit et jour à tout et à tout le monde dans une angoisse permanente de « rater » quelque chose, il semble que la vigilance face à l’éventualité d’un danger toujours possible soit inscrite dans notre cerveau depuis la nuit des temps. Dans notre immense majorité, nous vivons dans l’imminence d’une catastrophe.
Il y a là une vraie réflexion à avoir sur le fait de surmonter cette ambivalence, de s’autoriser à ne rien faire, mais aussi sur la manière dont nous investissons ce temps du non-faire. Peut-être faut-il réapprendre, comme les enfants, à réapprivoiser l’inattendu. A accepter d’être dans l’expectative, dans l’attente, dans l’ouverture, dans le repositionnement de nos priorités.
Car : « Ne rien faire requiert beaucoup de courage. Il ne s’agit pas de se laisser glisser d’un état à un autre sans effort de notre part. Mais bel et bien de rompre avec ses habitudes, de se remettre en question, de trouver de nouveaux points d’ancrage, d’accepter de regarder autrement le monde (…). Ainsi peut-on espérer devenir enfin pleinement soi-même dans ce constant échange entre l’action et le repos, le besoin de contrôler le monde et la puissance de la rêverie, la réalité et les songes. » (L’Art de ne rien faire-Catherine Laroze.)